Vers la fin de l’anti-parti et de l’abolocho rachitique
L’antipartisme manifeste chez bon nombre de nos compatriotes haïtiens est aujourd’hui si flagrant que ses symptômes sont perceptibles même par les plus aveugles de notre société. Sur les réseaux sociaux et dans les espaces publics, des voix sans engagement réel s’élèvent sans retenue, exprimant leur rejet du système électoral. Ils évoquent le contexte politique, la crise nationale, la corruption généralisée, entre autres, pour justifier leur position. Ce rejet se traduit par une posture d’électron libre, refusant toute affiliation à un courant ou à une ligne politique susceptible de produire un changement. Ce comportement devient une entrave directe à la démocratie, qui repose justement sur l’engagement citoyen comme pilier de la bonne gouvernance.
L’antipartiste, qui se veut à l’opposé de l’« abolocho », finit par incarner l’autre face d’une même pièce. Car, bien que leurs postures diffèrent, leur impact converge : empêcher l’émergence d’un véritable changement. L’antipartiste refuse de voter, convaincu que tous les candidats se valent, que son vote ne changera rien, ou que les élections sont systématiquement truquées. Ce raisonnement, bien qu’alimenté par une certaine frustration, ouvre la voie à l’élection de candidats souvent moins qualifiés, profitant du désengagement populaire.
L’« abolocho rachitique », quant à lui, ne parle que le langage de l’argent, des opportunités et des avantages personnels. Il n’est motivé par aucun idéal, et sa satisfaction s’arrête à la nuit des élections, en attendant le prochain coup pour vendre ses services. L’antipartiste, de son côté, sera le premier à commenter les résultats partiels, cherchant à prouver qu’il avait raison de ne pas voter. Ces deux attitudes, bien que différentes dans leur forme, nuisent toutes deux au processus de développement du pays.
Face à cette réalité, les vrais candidats, porteurs de projets sérieux, hésitent à s’engager, refusant de s’humilier devant une culture politique gangrenée par le cynisme et l’indifférence. Depuis l’avènement de la démocratie, notre problème central réside dans une gouvernance défaillante, menée par des hommes et des femmes qui ont accédé au pouvoir non par compétence, mais par audace malicieuse et compromis douteux.
Sortir de ce piège demande stratégie et détermination. Car les discours des abolochos rachitiques et des antipartistes résonnent et se propagent à une vitesse fulgurante, nourris par l’incivisme ambiant et l’absence d’éducation civique dans nos écoles et institutions.
Il est temps d’en finir. Il est temps que les femmes et les hommes intègrent les institutions politiques de leur choix, qu’ils militent activement, au lieu de rester sur le trottoir à se faire embarquer par des charlatans dont le chaos et l’effondrement de notre société leur servent de tremplin et définissent leur raison d’être.
Noel Emilius Fils
Sociologue




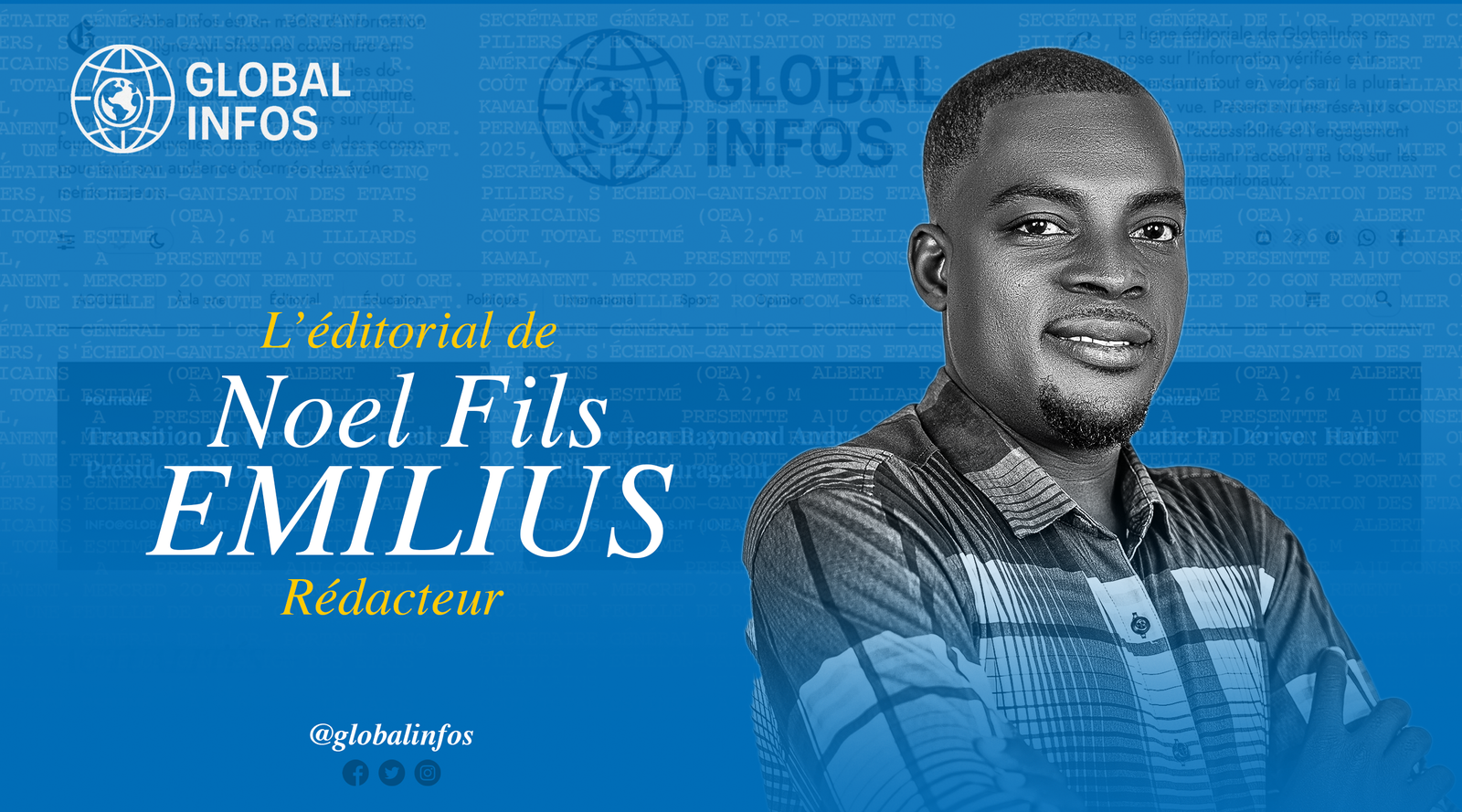
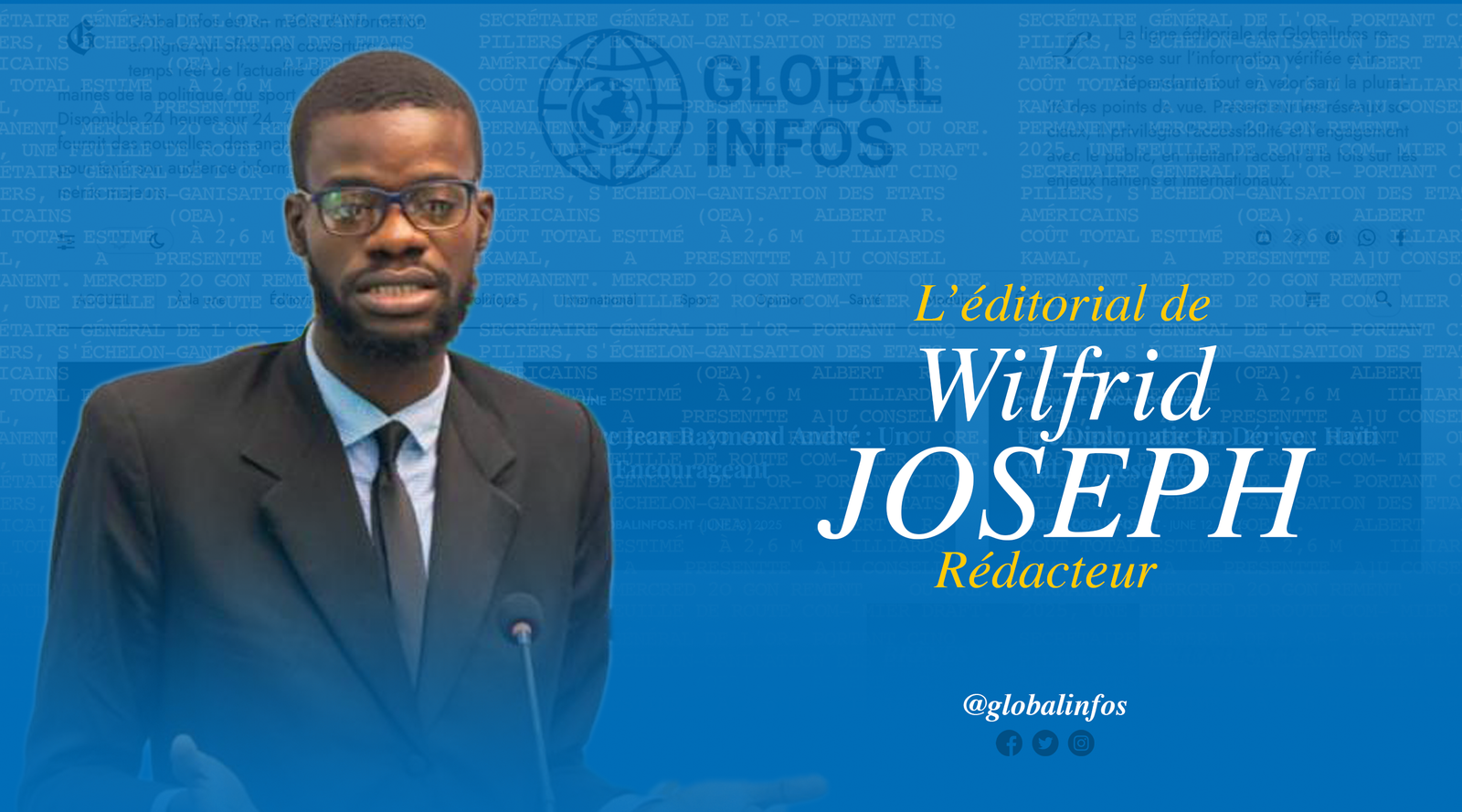


Idéologiquement , j’ai beaucoup apprécié ce que je viens de lire, même si je ne peux pas toujours être d’accord totalement avec l’auteur.
On peut dire , le texte a le mérite de pointer une double menace Politique et je pense que l’auteur est en accord avec ce qu’il avance : le retrait du citoyen (antipartisme) et le cynisme intéressé (abolocho). Toutefois, sa limite est qu’il ne propose pas une véritable pédagogie politique capable de réconcilier les Haïtiens avec l’engagement civique.
Noël Fils dénonce, mais reste insuffisamment normatif, ce que Anténor Firmin qualifie de [ jeu d’un camp ] : que faire concrètement pour recréer une culture de la participation ?
En définitive, l’analyse invite à dépasser le rejet et l’opportunisme pour renouer avec une politique du sens, où l’engagement ne se réduit ni à l’indifférence ni à la cupidité, mais à la recherche d’un projet collectif.🪡
Bon travail Noël 🫵🏾